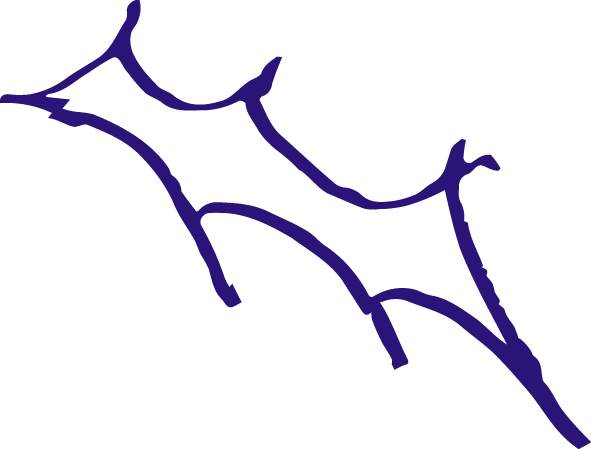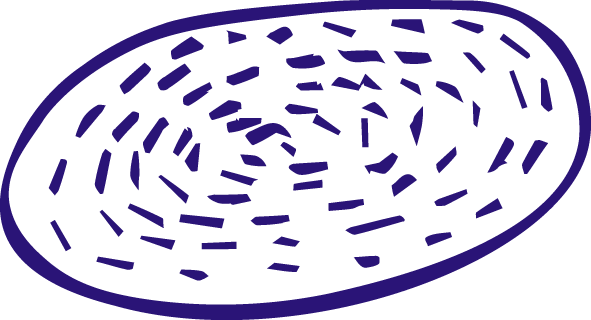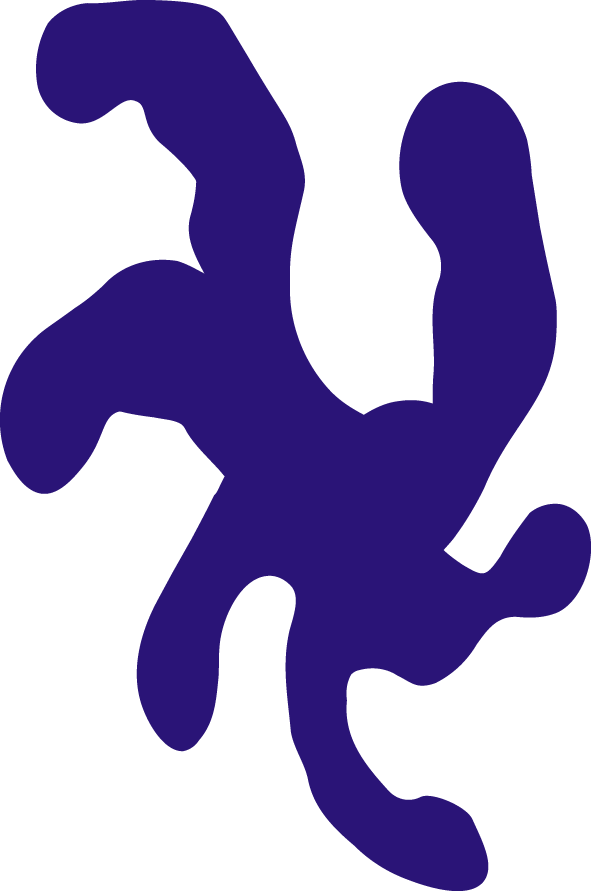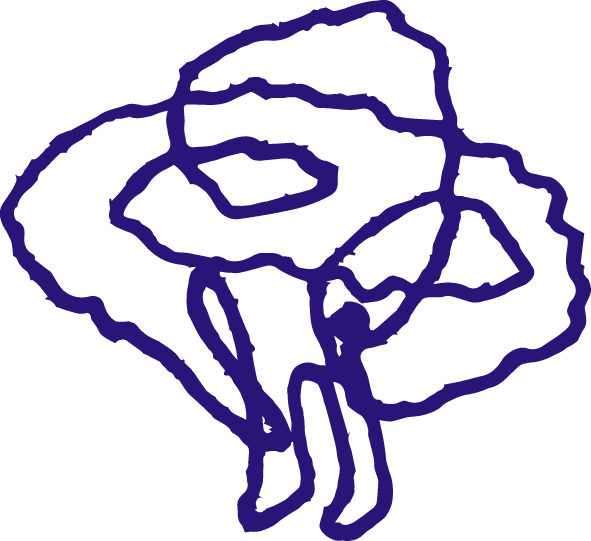Recherche-Action sur la Psychiatrie et les Alternatives

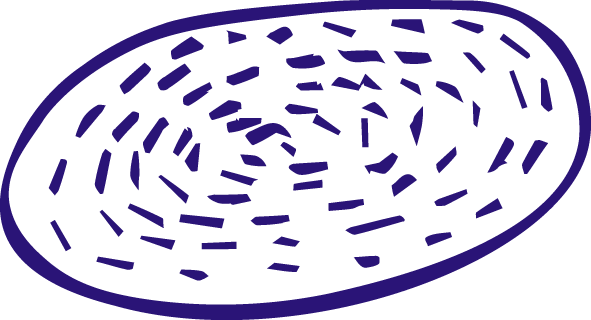
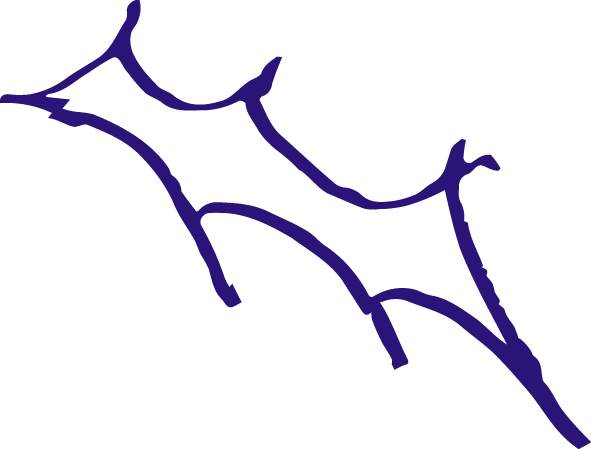


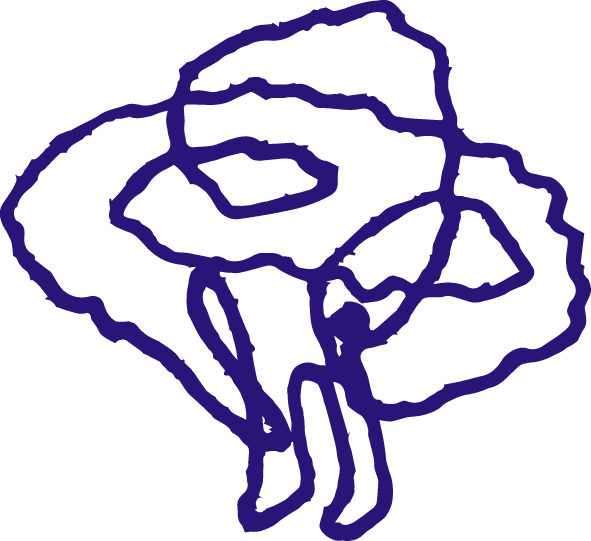

Savoirs d’usages au sujet de la médication psychiatrique
|
3 |
|
|
5 |
|
|
15 |
|
|
18 |
|
|
25 |
|
|
40 |
|
|
45 |
|
|
52 |
|
|
56 |
|
|
60 |
|
|
63 |
|
|
66 |
|
|
84 |
|
PROLOGUE
Ce livret est issu des questionnements et des partages qui ont surgi au sein du Groupe Médocs.
Nous ne désirons pas émettre d’avis tranché sur la prise de médicaments. Entre le besoin de mettre en débat un geste systématique de prescription de molécules psychiatriques, la nécessité de composer au mieux avec celles-ci ou un refus total de prendre des médicaments, il y a autant de possibilités et de besoins qu’il y a de personnes.
Le traitement médicamenteux en psychiatrie peut varier au fil du temps ; Celleux qui veulent modifier leur traitement de leur propre initiative ne se sentent pas toujours pris en compte. Notre démarche s’incarne aussi dans cette nécessité de prise en compte et de considération.
Plusieurs d’entre nous se sentent seul·es dès lors qu’il s’agit d’aménagement, de diminution ou de désir d’arrêt de la médication. Pourquoi pas élaborer ici des idées et des équipements qui permettraient de composer avec ces désirs ?
J’ai été maltraitée en psychiatrie et médiquée de force et sous menaces. Les médicaments ont fortement aggravé mon état de santé, ainsi que les enfermements dans des unités fermées, loin de la vie quotidienne, loin des ami·es, de la famille, de l’école, coupée de tout.
Je crois que d’autres réponses que celles offertes par la psychiatrie en Belgique sont possibles. Il y a d’autres réponses, elles sont moins visibles que ce que propose la psychiatrie conventionnelle. Je suis en recherche, en cheminement depuis des années. Comme je refuse la médication, je n’ai pas le soutien des psychiatres. Ils croient que je refuse les soins, alors que justement, je recherche de vrais soins.

UN GROUPE MÉDOCS
Nous sommes une quinzaine d’humain·es, toustes concerné·es par l’usage des médicaments psychotropes.
Quand on prend des médocs, on se sent parfois très enfermé·es en soi-même.
Le fait d’en parler, d’échanger à ce sujet est crucial pour chacun·e d’entre nous.
On a réfléchi ensemble nos rapports aux médicaments.
Certain·es d’entre nous sont mal à l’aise avec une dépendance à la médication ; beaucoup d’entre nous prennent des médocs et n’ont pas eu le choix. Nous ressentons comme un besoin de se réappro-prier les choses ; de ne pas subir nos traitements.
Nous pensons que les médicaments ne résolvent pas à eux seuls les troubles psychiques.
Certain·es d’entre nous envisagent même que les médicaments nous rendent un peu plus malades.
On s’est parlé de cela, sans tabou, dans un espace où la parole était libre.
On a tenté de faire attention à notre vocabulaire pour créer notre propre rapport aux médocs ; on a utilisé, on s’est créé de nouveaux mots.
On a prêté attention aux mots qu’on employait ; parce que les mots agissent sur nous à notre insu, comme ils agissent aussi sur les autres qui les entendent — nos prescripteurs et prescriptrices les premier·es.
Comment avons-nous fonctionné concrètement ?
On a commencé par un jeu d’écriture, dont on vous livre les quelques lignes…
C’est quoi ce groupe
MÉDOCS ??
Ce groupe consiste à compenser le manque d’infos. Moins de confusion et de somnolence. Besoin d’être entier·e sans soumission. (Zohra avec les mots de Philippe)
Pour une réorganisation fructueuse, il faut cercler cette inconnue qu’est la médication et oublier ses réflexes, son conditionnement et cesser de se cacher derrière un paravent. (Philippe avec les mots de Thomas)
Notre groupe a l’envie de pouvoir, en toutes précautions, permettre à l’être humain de s’affirmer dans la politique des soins actuelle. (Sophie avec les mots de Stéphane)
Notre groupe propose un espace de dialogue avec d’autres personnes intéressées par la question de la médication, pour tendre vers une meilleure connaissance de soi en matière de besoins thérapeutiques et pour, in fine, tendre vers plus d’autonomie (Stéphane avec les mots de Quentin)
Notre groupe, c’est une prise de conscience de l’incompréhension face à la dépendance, à la fragilité et à l’anormalité. C’est un lieu qui ne stigmatise pas. (Auré avec les mots de Zohra)
Ce groupe est une boîte noire formée d’êtres humains plein d’ambiguïtés qui cherchent peut-être des béquilles pour soigner une identité pétrie d’ambivalence. (Fatiha avec les mots de Sophie)
Grâce aux neurones et à mon système nerveux, mes systèmes limbiques peuvent gérer mon hippocampe par la GAM quebecoise !! (Audrey avec les mots de Patricia)
Notre groupe vise à guérir les médecins de leurs douleurs d’arrêter la vie des malades et ce à dose homéopathique, ouille ! OU notre groupe vise à rendre un côté homéopathique à nos douleurs en arrêtant de nous penser malade, en refusant de laisser aux médecins le pouvoir de la médication, en se réappropriant notre guérison, le sens qu’on lui donne subjectivement et les droits à défendre collectivement, ouille ouille ouille ! (Étienne avec les mots de Sophie)
Notre groupe ici, c’est une responsabilisation collective, une liberté construite ensemble, sur base du constat que notre relation aux médicaments est complexe, en ce sens qu’elle s’adresse à nos émotions, questionne la gestion, le contrôle et des facettes floues de notre parcours. (Thomas avec les mots de Fatiha)
Les psychiatres sont-iels en conscience que les patient·es sont des êtres à part entière ? Et que les médicaments psychiatriques ne peuvent pas ou peut-être pas nettoyer le système limbique (centre des émotions) ? Ne sont-iels pas des apprenti·es sorcier·es ? Nous prennent-iels pour des cobayes ? Ont-iels des avantages en nature des firmes pharmaceutiques ? (Patricia avec les mots d’Étienne)
Ce groupe est important afin de mettre des mots sur nos histoires et les sortir des livres, pour les remettre dans la vie ! C’est un bon moyen de sortir de nos deuils et de remettre à (beaucoup) plus tard nos funérailles, na ! (Sophie avec les mots d’Audrey)
Notre groupe est un espace collectif de partage d’expériences et de savoirs (Quentin avec les mots d’Auré)
On s’est d’abord beaucoup parlé, on s’est raconté ; on a commencé par s’échanger des témoignages.
On s’est réuni à peu près toutes les deux semaines / il y a eu des débats.
On a utilisé toutes sortes de ressources : documentaires (radio et audiovisuels) / exercices d’écriture / jeux de rôles, recherches personnelles, enregistrements, PAD collectif d’écriture, … on s’est informé les un·es les autres.
Notre méthode…
Expérimentale ⇢ on ne sait pas très bien où on va, ni ce qu’on va découvrir
On est des vraies exploratrices ! (dit Sophie) ;
On circule dans des véhicules polyformes (dit Thomas) ;
Question du rythme/de s’autoriser d’avancer en groupe dans une forme de lenteur et de flottement (dit Philippe)
Pourquoi définir a priori une méthode ? Pourquoi ne pas se laisser la liberté de la cerner a posteriori, comme on fait un album de photos de vacances ?
Pourquoi, selon nous, est-ce important
qu’un groupe comme le nôtre
existe / se mette au
travail ?
CAR : Il y a très peu d’endroits où il est possible de parler des médocs de façon collective, sans la présence d’un·e professionnel·le du soin ou de la médication. Sans qu’on soit dans des enjeux de psychoéducation.
CAR : il nous semble important d’activer d’autres savoirs sur les médicaments psychiatriques, en transversalité, et entre pairs. Importance de rendre compte de nos savoirs pratiques, issus des usages que nous faisons des médicaments jour après jour.
CAR : c’est vital de comprendre / faire comprendre / prévenir / créer une source d’information alternative sur les médocs à destination de nos pairs et de nos médecins, de nos soignant·es — elleux-mêmes possiblement influencé·es par les sources d’information standardisées des firmes pharmaceutiques.
CAR : nous souhaitons fournir une (autre) réponse, plus ajustée en termes d’égards et de souci, par rapport aux désirs d’arrêt / réduction de la médication / on doit pouvoir entendre et proposer un cadre délicat en vue que cette expérimentation puisse être vécue le mieux possible ⇢ une porte de sortie plus créative face au sempiternel « n’arrête pas, ça va mal se passer ! » ou « tu vas devoir prendre des médocs toute ta vie » ; construire ensemble une démarche — issue de la somme des expériences au sein du groupe — visant à explorer nos questionnements (multiples — y compris d’arrêt ou de réduction) au sujet de nos médicaments.
CAR : quand on vit « Le cri du Munch » / quand on est dans le fond — qui est là pour avoir une réaction adéquate par rapport à ce qu’on vit ? Si personne n’est là, il n’y a plus que les médicaments… Le groupe pourrait ébaucher le début d’une autre réaction / réponse « au cri de Munch ».
CAR : nos médocs sont également de puissants réorganisateurs des milieux qu’ils traversent. L’air de ne pas y toucher, ils transforment aussi les pratiques de soins dans lesquelles ils s’installent — pratiques qui nous sont destinées…
Que vise notre groupe ?
Créer un contre-discours / faire contrepoids face à un discours conventionnel sur les médocs (« si tu arrêtes, ça va mal se passer, tu prendras des médocs toute ta vie, seuls les médecins et les pharmacien·nes sont des spécialistes des médicaments »). Construire ensemble une réponse plus riche, issue de la somme des expériences au sein du groupe.
Importance de la transmission ⟿ comme ce qui se passe aujourd’hui ! // envie de rencontrer nos pairs mais aussi des équipes de soignant·es pour échanger sur la question des médocs et de notre recherche.
S’allier à toutes celles et ceux qui s’autorisent à poser un regard critique et constructif sur les façons d’accueillir et de composer avec du trouble psychique, dès lors qu’il vient se nicher dans nos existences.
Bisous
Valérie, Sophie, Marion, Thomas, Sonia, Philippe, Agapao, Stéphane, Patricia, Audrey, Daniel, Valère, Lionel, Fabrice, Valérie et Auré.
Mouvement de va et vient ; Reprendre la confiance en période sombre ; d’abord chercher l’énergie pour ne pas rester dans le sombre difficilement dicible / indescriptible ; ensuite chercher des allié·es (mots, choses, air, personnes, idées etc.) qui aident à créer une ouverture (un point lumineux dans la pénombre), c’est cette ouverture qui aide à reprendre confiance.
Les vagues délirantes se mettent en place quand la réalité est devenue trop insupportable, insurmontable et ingérable. C’est un système de défense ; c’est jamais que la traduction du « je suis pas bien dans ma peau ». Les hallucinations une langue à part entière pour essayer de faire sens de ça. Pour leur donner une forme concrète, matérielle.
DÉCULPABILISER
On a tendance à s’écraser devant les psychiatres, à penser qu’iels savent mieux que nous, mieux que notre expérience directe de nos symptômes, notre souffrance, notre vécu des effets indésirables. On est des sujets adultes avant d’être des patient·es ou des usager·es. Le système médical et psychiatrique ne reconnait pas toujours notre capacité et notre droit à nous connaitre et faire des choix. Mais que nos pairs nous reconnaissent cette légitimité, c’est un premier pas pour la reconnaitre soi-même. Moi c’est ce que le Groupe Médoc m’a donné et que je veux dire ici.
Notre démarche se déroule comme un cheminement, un questionnement en continu. Dérouler la question du médicament au fil de la vie, explorer la situation particulière de chacun·e d’entre nous.
On ressent parfois beaucoup de pression.
La pression de les prendre parce qu’on est perçu·es comme « fragile ». De ne pas les prendre parce qu’on devrait être plus « fort·e ». Alors que ne devrait importer que ce qui nous convient et nous soutient à un moment donné.
Considération et temps pour pouvoir mieux explorer ; et cette exploration inclut la possibilité de changer d’avis, de faire des aller-retours, des essais-erreurs.

TEMPS
Je suis légitime de prendre le temps.
J’ai le droit de prendre le temps qu’il faut.

CONSIDÉRATION
Je suis légitime de questionner mon traitement.
Légitime d’exiger que mes demandes/questions
soient prises au sérieux.
J’ai le droit à des réponses plus créatives, personnelles,
originales.
CHEMINEMENT
Nos trajectoires sinueuses
Nous sommes toutes et tous embarqué·es dans l’histoire de notre vie. C’est pareil pour tout le monde, on chemine comme on peut. Ce qui n’est pas pareil pour tout le monde, c’est le chemin.
Sur ce chemin, on s’est dit que c’était parfois intéressant de prendre un temps de pause pour regarder le paysage et reprendre son souffle avant d’arpenter de nouveaux sentiers.
À quoi ressemble ce paysage ?
- Où te trouves-tu ?
- Te sens-tu fatigué·e ou en pleine forme ?
- Quelle émotion ressens-tu ?
- Te sens-tu reposé·e ou agité·e ?
- As-tu faim ?
- Où dors-tu ?
- Te sens-tu pauvre / riche de qqch ?
- Ta famille est ici ?
- Tes ami·es traînent dans le coin ?
- Tes voisin ·es sont par là ? De qui te sens-tu proche ?
- En qui as-tu vraiment confiance ?
- Qui souhaites-tu ne pas / plus voir dans ce paysage ?
- Quels sont les lieux qui en font partie ?
Diagnostic
Dans le DSM (Manuel diagnostique et satistique des troubles mentaux), le diagnostic est fondé sur une liste/un regroupement de symptômes particuliers. Ces symptômes sont alors perçus comme les signes d’une maladie nichée au plus profond de nous, une pathologie propre à nous seul·es.
En chemin, certain·es d’entre nous ont eu besoin de mettre un mot sur les troubles qu’ils ressentent, d’autres ont eu peur qu’un mot viennent figer un état de troubles. D’autres encore ont ressenti de la terreur face au mot prononcé en guise de diagnostic, un mot qui déclasserait/qui condamnerait à tout jamais.
On peut voir le diagnostic comme une balise provisoire qui oriente une trajectoire à un moment donné de la vie, et ne pas vouloir en faire une identité.
On peut entendre le diagnostic comme un soulagement, la reconnaissance — enfin formulée — de nos difficultés ou de nos différences. Ce diagnostic peut alors constituer un outil d’acceptation/explication pour moi et les autres.
Est-ce que je suis prêt·e ? Est-ce que je m’autorise à prendre soin de moi, à me porter secours, à faire des choix autonomes qui vont parfois à l’encontre de la pression de l’entourage ou des blouses blanches ? Est-ce que je veux supprimer mon symptôme ou est-ce que je fais le choix de le garder ? Parfois j’étais d’accord de choisir la suppression du symptôme au prix des effets secondaires, et parfois pas. Parfois j’étais prêt·e à faire face à mon symptôme seule, j’avais besoin de faire face à mon symptôme seule. Parfois j’avais besoin de plus de soutien que je n’en avais face à mon symptôme, et j’ai augmenté les doses. Alors en toute logique, le peu d’effet qu’avaient eu les médocs ont fini par disparaître. Les voix ont hurlé de plus en plus fort. Parce que ça rendait malade, parce que ça abîmait. Et quand j’expliquais ça aux soignant·es, on augmentait mon dosage. Et les voix hurlaient de plus en plus fort tandis que mon corps s’alourdissait, se déformait, se déréglait, se brisait de plus en plus sous les effets secondaires. J’ai dit : « les médicaments me rendent malade » ; on m’a répondu : « on peut vous les faire en injection ». J’ai refusé. On m’a accusé d’être dans le déni, en refus de soin.
C’est du cas par cas, du sur-mesure
En fonction de qui / où on est, des portes sont + ou - accessibles.
Les fausses routes font partie de l’exploration / du chemin pour s’approprier son traitement, ses difficultés. Le cheminement est fait d’essais-erreurs. On découvre des techniques, des méthodes, on apprend à savoir comment on fonctionne.
Pouvoir détecter l’arrivée d’une explosion en soi, c’est crucial.
Connaître les lieux, les genxtes ou les choses à éviter pour son propre bien l’est tout autant.
Avoir un ou des lieux de repli. Avoir autour de soi des personnes capables d’accueil, d’écoute, d’acceptation. C’est bien plus qu’une question de médicaments…
Les thérapies alternatives à la psychiatrie et à la psychothérapie peuvent parfois faire partie du cheminement ; mais elles ne sont actuellement pas remboursées par la sécurité sociale. Elles sont souvent chères, ce qui les rend difficile d’accès.
Au fil de nos rencontres, nous avons réalisé combien il était précieux de partager nos expériences, le flou de nos ressentis, de les mettre en mots sans y coller d’étiquettes. Certain·es d’entre nous ressentent le diagnostic et le vocabulaire des soignant·es comme quelque chose qui nous dépossède de nous-même. Le regard extérieur sur nos troubles semble remplacer nos vécus intérieurs et le vocabulaire professionnel réduit de vastes pérégrinations à de petites étiquettes (angoisse, dépression, hallucination, etc.).
Nous avons une histoire (sociale, affective, économique, familiale) dont nos émotions / vécus sont le reflet. Le danger du diagnostic, c’est de ne plus voir la complexité intrinsèque de chacun·e d’entre nous et de rétrécir le regard en un mot qui stigmatise ; le danger, c’est aussi de figer une expérience par un mot d’expert·e.
Certaines émotions que nous ressentons (tristesse, joie, etc.) peuvent aussi être considérées pour ce qu’elles sont dans nos vie, sans en faire forcément / systématiquement les signes d’un diagnostic psychiatrique déterminé.
Errance médicale
Faire une prise de sang, avoir une attention pour un (possible) problème physiologique.
Au départ d’une prise en charge, la prescription de médicaments psychiatrique ne s’accompagne pas toujours d’une analyse sanguine ; or il y a certains symptômes diffus qui peuvent relever d’autre chose que d’une pathologie psychiatrique. Très peu d’entre nous ont bénéficié de cette exploration préliminaire (cf. endocrinologie, neurologie).
Gardons à l’œil qu’il y parfois une forme d’hyper spécialisation qui rétrécit l’exploration des symptômes pour lesquelles on va consulter.
Il m’a fallu 25 ans pour qu’on découvre chez moi que mon état de ralentissement n’était pas dû à une dépression majeure mais à une hypothyroidie subclinique. Entretemps, avant qu’on me prescrive qqch pour ma thyroide (L-Tyroxine), j’ai pris beaucoup d’antidépresseurs.
NOS MÉDICAMENTS
Les Anxiolytiques
Un anxiolytique (appelé aussi par certain·es d’entre nous tranquillisant) est un médicament destiné à traiter les troubles anxieux, c’est-à-dire un sentiment basé sur une peur / angoisse (qui peut avoir un objet ou non). Les plus courants sont les benzodiazépines. Ce sont des molécules qui ont une portée rapide et qui diminuent les effets émotionnels et physiques. Leur utilisation doit être très prudente, car des molécules peuvent créer une certaine accoutumance voire un état de dépendance après plusieurs mois d’utilisation quotidienne.
|
BENZODIAZÉPINES (molécules) |
EXEMPLES DE MÉDICAMENT ENREGISTRÉ |
|
Alprazolam |
Xanax |
|
Alpraz |
|
|
Alprazolam (EG, Kela, Sandoz, Teva, etc.) |
|
Alprazomed |
|
|
Docalprazo |
|
|
Topazolam |
|
|
Bromazepam |
Lexotan |
|
Bromazepam (EG, Sandoz, Teva, etc.) |
|
|
Bromidem |
|
|
Docbromaze |
|
|
Kelalexan |
|
|
Brotizolam |
Lendormin |
|
Clobazam |
Frisium |
|
Clonazépam |
Rivotril |
|
Clorazépate |
Tranxène / Uni-Tranxène |
|
Clotiazépam |
Clozan |
|
Cloxazolam |
Akton |
|
Diazépam |
Valium |
|
Diazepam (EG, Teva, etc.) |
|
|
Flunitrazépam |
Rohypnol |
|
Flunitrazepam EG |
|
|
Flurazepam |
Staurodorm |
|
Loflazépate |
Victan |
|
Loprazolam |
Dormonoct |
|
Lorazépam |
Serenase |
|
Temesta |
|
|
Docloraze |
|
|
Lauracalm |
|
|
Lorazemed |
|
|
Lorazepam (EG, Teva) |
|
|
Lorazetop |
|
|
Loridem |
|
|
Optisedine |
|
|
Lormetazepam |
Loramet |
|
Doclormeta |
|
|
Keladormet |
|
|
Loranka |
|
|
Lormetamed |
|
|
Lormetazepam (EG, Teva) |
|
|
Metatop |
|
|
Noctacalm |
|
|
Noctamid |
|
|
Octonox |
|
|
Sedaben |
|
|
Stilaze |
|
|
Midazolam |
Dormicum |
|
Nitrazepam |
Mogadon |
|
Nitrazepam Teva |
|
|
Nordazepam |
Calmday |
|
Oxazepam |
Seresta |
|
Oxazepam (EG, Teva) |
|
|
Tranquo |
|
|
Prazepam |
Lysanxia |
|
Trazolam |
Halcion |
|
DIVERS (molécules) |
|
|
Zolpidem |
Stilnoct |
|
Zaleplon |
Sonata |
Les Antidépresseurs
Les antidépresseurs sont des médicaments prescrits dans le but de traiter les symptômes d’une dépression : tristesse, idées noires, abattements, insomnies, angoisses etc. Généralement, on distingue deux catégories de dépression : la dépression sévère et la dépression modérée ou légère, de très loin la plus fréquente, et qui ne nécessite la prise d’antidépresseurs qu’au cas par cas
Il existe 4 grandes familles d’antidépresseurs et une trentaine de médicaments différents. Les différentes catégories sont :
- Inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine (ISRS)
- Inhibiteurs de la sérotonine et de la noradrénaline (IRSN)
- Inhibiteurs de la monoamine oxydase (IMAO)
- Imipraminiques ou tricycliques
|
ISRS (molécules) |
EXEMPLES DE MÉDICAMENTS ENREGISTRÉS |
|
Citalopram |
Cipramil |
|
Citalopram (EG, Sandoz, Teva, etc.) |
|
|
Escitalopram |
Sipralexa |
|
Fluoxetine |
Fontex |
|
Prozac |
|
|
Docfluoxetine |
|
|
Fluox |
|
|
Fluoxemed |
|
|
Fluoxetine (EG, Teva, etc.) |
|
|
Fluoxone |
|
|
Prosimed |
|
|
Fluvoxamine |
Floxyfral |
|
Fluvoxamine (EG, Sandoz, Teva) |
|
|
Paroxetine |
Aropax |
|
Seroxat |
|
|
Paroxetine (Sandoz, Teva, EG) |
|
|
Sertraline |
Serlain |
|
Merck / Doc Sertraline |
|
|
Sertraline (EG, Sandoz, etc.) |
|
|
IRSN |
|
|
Duloxetine |
Cymbalta |
|
Venlafaxine |
Efexor |
|
IMAO |
|
|
Phenelzine |
Nardelzine |
|
Moclobémide |
Aurorix |
|
Moclobemide Sandoz |
|
|
ANTIDÉPRESSEURS TRICYCLIQUES (molécules) |
|
|
Amitriptyline |
Redomex |
|
Tryptizol |
|
|
Clomipramine |
Anafranil |
|
Dosulepine |
Prothiaden |
|
Doxepine |
Sinequan |
|
Imipramine |
Tofranil |
|
Maprotiline |
Ludiomil |
|
Nortriptyline |
Nortrilen |
|
AUTRES (molécules) |
|
|
Mianserine |
Lerivon |
|
Mirtazapine |
Remergon |
|
Mitrazepine (EG, Sandoz, Merck, etc.) |
|
Reboxetine |
Edronax |
|
Trazodone |
Trazolan |
|
Doctrazodone |
|
|
Nestrolan |
|
|
Trazodone Teva |
|
|
Hypericum perforatum-extract |
Hyperiplant |
|
Milperinol |
Les régulateurs de l’humeur
Aussi appelés thymo-régulateurs ou normo-thymiques, ces médicaments psychotropes sont utilisés pour traiter les symptômes des « troubles de l’humeur » et des « troubles bipolaires ». Ils sont prescrits dans le but de stabiliser l’humeur (diminuer les ressentis de tristesse, d’angoisse, de dévalorisation de soi-même et de manque de motivation). Et pour atténuer l’euphorie, l’hyperactivité, l’irritabilité, l’insomnie lors de la phase dite maniaque.
|
ANTIÉPILEPTIQUES |
|
|
Acide Valproïque |
Depakine |
|
Convulex |
|
|
Merck-Valproate |
|
|
Carbamazepine |
Tegretol |
|
Trileptal |
|
|
Merck — Carbamazepine |
|
|
Lamotrigine |
Lamictal |
|
Lampibol |
|
|
Lamotrigine (Bexal, EG etc.) |
|
LITHIUM |
|
|
Carbonate de Lithium |
Camcolit |
|
Maniprex |
|
|
Priadel |
Autres
|
STIMULANTS CENTRAUX |
|
|
Methylphenidate Chlorhydrate |
Concerta |
|
Rilatine |
|
|
Atomoxidine |
Strattera |
|
ANTICHOLINERGIQUES |
|
|
Biperidene |
Akineton |
|
Trihexypheenidyle |
Artane |
|
Orphenadrine |
Disipal |
|
Procyclidine |
Kemadrin |
|
Dexetimide |
Tremblex |
|
OBÉSITÉ |
|
|
Sibutramine |
Reductil |
|
TABAGISME |
|
|
Bupropion |
Zyban |
|
Varenicline |
Champix |
|
ALCOOLISME |
|
|
Disulfirame |
Antabuse |
|
Acamprosate |
Campral |
|
Tiapride |
Tiapridal |
|
Piracetam |
Nootropil |
|
Noodis |
|
|
Braintop |
|
|
Docpirace |
|
|
Geratam |
|
|
Piracemed |
|
|
Piracetam (Teva, Ucb, etc.) |
|
|
Midazolam |
Dormicum |
|
HÉROÏNE ET OPIACÉS |
|
|
Methadone |
Préparation magistrale |
|
Mephenon |
|
|
Subutex |
|
|
Clonidine |
Catapressan |
|
ALZHEIMER |
|
|
Donepezil |
Aricept |
|
Galantamine |
Reminyl |
|
Rivastigmine |
Exelon |
|
Ginkgo Biloba extraits |
Tanakan |
|
Tavonin |
Les Antipsychotiques
Les antipsychotiques sont utilisés pour traiter les troubles dits « psychotiques aigus », dont la « schizophrénie », ou lors des accès thymiques (accès maniaque ou dépressif) de certains troubles. Ils agissent sur les récepteurs D2 de la dopamine qu’ils bloquent ou dont ils modifient les effets. Il est rapporté que ces médicaments sont surtout prescrits lorsque sont décrites des expériences qualifiées d’« hallucination » et/ou de « délire » par le corps médical.
Les antipsychotiques de première génération avaient comme effet indésirable des troubles moteurs (tremblements, mouvements anormaux). Les antipsychotiques de deuxième génération (commercialisés depuis les années 1980/1990) sont mieux tolérés d’un point de vue neurologique. Leurs effets secondaires sont une prise de poids parfois importante, qui peut être à l’origine d’un diabète, d’une hypercholestérolémie. Il y a dautres effets indésirables comme une hyperprolactinémie (la dopamine régulant la sécrétion de prolactine) à l’origine d’une aménorrhée (plus de règles) et au long cours, rarement, d’une décalcification osseuse.
|
PHÉNOTHIAZINES |
|
|
Prothipendyl |
Dominal |
|
Levomepromazine |
Nozinan |
|
THIOXANTHÈNES |
|
|
Zuclopenthixol |
Clopixol |
|
Flupentixol |
Fluanxol |
|
Clotiapine |
Etumine |
|
BUTYROPHÉNONES |
|
|
Melperone |
Buronil |
|
Droperidol |
DHB |
|
Pipamperone |
Dipiperon |
|
Benperidol |
Frenactil |
|
Haloperidol |
Haldol |
|
Bromperidol |
Impromen |
|
DIPHENYLBUTYLPIPERIDINES |
|
|
Fluspirilène |
Imap |
|
Pimozide |
Orap |
|
Penfluridol |
Semap |
|
BENZAMIDES |
|
|
Sulpiride |
Dogmati |
|
Docsulpiri |
|
|
Sulpiride (EG, Teva) |
|
|
Veralipride |
Agreal |
|
Levosulpiride |
Levopraid |
|
Amisulpride |
Solian |
|
Merck Amisulpride |
|
|
ANTIPSYCHOTIQUES ATYPIQUES |
|
|
Aripiprazole |
Abilify |
|
Risperidone |
Risperdal |
|
Quetiapine |
Seroquel |
|
Olanzapine |
Zyprexa |
|
Clozapine |
Leponex |
|
Clozapine Sandoz |
|
|
Sertindole |
Serdolect |
|
Paliperidone |
Invega |
Comment agit un médicament ?
Un médicament, c’est puissant ! Et ça agit à plein de niveaux : pas seulement sur l’humeur, mais aussi sur différentes fonctions (circulatoire) et sur différents organes (le foie, les reins).
Donc sur mon corps…
Les médicaments prescrits en psychiatrie sont des substances psychotropes. Ces substances agissent (principalement) sur le système nerveux central en altérant ses fonctions.
En altérant les fonctions du système nerveux central, un médicament induit des modifications de la perception, des sensations, de l’humeur, de la conscience (états modifiés de conscience) et d’autres fonctions psychologiques et comportementales.
L’objectif premier d’une médication est de tenter de soulager provisoirement la souffrance de la personne.
Dans mon esprit…
Selon qui on est, notre histoire, notre milieu, on considère les médicaments psychiatriques d’une façon plus ou moins positive. Les émotions, les impressions et les images qu’on a de nos médicaments sont multiples… et changeantes ! Elles se modifient souvent au fil du temps et en fonction du cours de notre vie.
Sonder nos représentations/croyances autour de nos médicaments peut passer par un petit exercice : lorsque je pense aux médicaments que je prends, quels sont les mots qui me viennent instantanément à l’esprit ? Quelle est l’aide / l’effet que j’attends d’eux ?
Au sein de notre groupe, les représentations de nos médocs vont de la peur au soulagement, en passant par l’argent, le contrôle social, le miracle ou l’autonomie.
Questions à méditer
- Depuis quand je prends des médicaments ? Pourquoi ?
- M’a-t-on bien expliqué les effets des médicaments qui me sont prescrits ? Quelle molécule pour quel effet ? Pourquoi un traitement ? Symptôme et / ou vécu émotionnel et physique
- Comment s’est mise en place ma première médication ?
- Ai-je eu le choix / le temps ?
- Pourrais-je imaginer ma vie avec moins / sans médicaments ?
- Est-ce que je sens des effets qui me gènent ?
- Comment réagit mon entourage par rapport à mes médicaments ?
J’ai eu plusieurs prescripteurices ou pairs consommateurices qui m’ont dit beaucoup de choses différentes sur les éventuels effets secondaires. Au final, j’en ai expérimenté certains et pas d’autres, j’ai dû me fier à mon vécu au fur et à mesure.
Un de mes médocs a un effet désinhibant, quand je le prends c’est un peu comme si j’étais saoule, donc je fais parfois des choses que je ne ferais pas sans. Un autre a des effets secondaires cognitifs: moins bonne mémoire, moins bonne capacité à réfléchir, etc. Quelque chose qui est un effet recherché et pas secondaire m’inspire des sentiments contradictoires. Comme mes médocs diminuent l’intensité de mes émotions, notamment ma colère, je le vis parfois comme une atteinte à mon individualité, une manière d’écraser la capacité à se défendre et se rebeller.
Balance tes médocs ! (page gribouillis)
Un peu d’histoire
Comment une molécule devient un médicament ?
D’abord, un produit naît — il est volontairement appelé « produit » puisqu’il est issu de l’industrie pharmaceutique.
Un BREVET va être déposé par la firme qui souhaite protéger la formule de son produit. C’est le fameux R pour « Registered ».
Un nouveau médicament lancé sur le marché par une firme pharmaceutique est protégé par un brevet durant 20 ans à partir de la découverte de la substance active à l’origine dudit médicament. Pendant toute la période de ce brevet, seule cette firme peut commercialiser le nouveau médicament.
Passée cette période, d’autres firmes pharmaceutiques peuvent mettre cette même substance active en vente sous un autre nom — si elles apportent la preuve qu’il a le même effet et qu’il est au moins 31% moins cher que le médicament de référence. Il s’agit alors d’un médicament générique.
Ce médicament générique doit être, comme tout autre médicament, enregistré par le Ministère de la Santé publique, et pour cela, il doit répondre à une série de critères de qualité :
- obtenir le même principe actif (ou substance active) que le médicament original
- avoir le même dosage (quantité de substance active par médicament)
- se présenter sous la même forme (par exemple comprimé ou gélule, sirop…).
Notons en passant que le principe actif contenu dans un médicament générique répond aux mêmes exigences de qualité que celui d’un médicament de marque. Il arrive d’ailleurs fréquemment que le principe actif d’un produit original et de sa copie soient fabriqués dans la même firme… Et si les génériques ont une autre forme ou une autre couleur que leurs équivalents, cela n’a aucune incidence sur leur efficacité ou leur rapidité d’action.
Pour obtenir l’ouverture d’un marché (et d’autant plus si l’on vise un
remboursement par les assurances et les mutuelles), il faut prouver que l’on vend un médicament et que l’on
soigne une maladie.
On passe alors aux ESSAIS CLINIQUES. Ils existent pour étudier l’efficacité des
médicaments ainsi que leurs éventuels effets secondaires sur les genxtes qui les prennent.
Les essais cliniques, comment ça se passe ?
Il existe un modèle de référence pour la production d’essais fiables, les « randomised control trials ». Ces études trouvent leur origine dans le test des antibiotiques contre les maladies infectieuses.
Ces essais sont généralement de très courte durée (entre 1 et 2 ans grand maximum) et nécessitent 4 grands ingrédients :
- Un groupe de patient·es atteints d’une même pathologie (c’est ce qu’on appelle « l’échantillon »)
- La possibilité d’administrer la substance active que l’on souhaite tester à la moitié de ce groupe de patient·es
- La possibilité d’administrer un placébo (non différenciable de la substance que l’on souhaite tester) à l’autre moitié du groupe de patient·es
- Des outils permettant d’évaluer / juger l’évolution de la pathologie et l’apparition d’éventuels effets secondaires
Les premier et dernier ingrédients sont les plus difficiles à trouver et, de ce fait, demeurent les plus controversés. D’une part, il n’est pas rare que 40 à 50 pays soient impliqués dans un même essai — on recrute des médecins qui vont s’occuper de 3 ou 4 malades par pays et additionner tous ces malades issus de pays différents afin d’obtenir un échantillon important mais quelque peu hétérogène / malheureusement peu homogène. D’autre part, les outils de mesure et d’évaluation varient sans cesse.
Notons en passant que ces randomised control trials sont des études très couteuses. Pour cette raison, ces essais ne peuvent être réalisés que par des firmes pharmaceutiques à rentrées financières solides. Celles-ci sous-traitent parfois des études à des sociétés privées (on parle de Contract Research Organization — CROs) plutôt qu’à des centres académiques. Ensemble, elles fixent seules les règles méthodologiques avant de s’assurer la participation de médecins cliniciens qui ont beaucoup à y gagner financièrement ainsi qu’en termes de notoriété. Dans l’objectif de limiter le coût, Ces CROs ont déplacé la réalisation des études cliniques dans d’autres régions du globe (Europe de l’Est, Asie, Afrique).
Afin de vendre leur médicament, les firmes pharmaceutiques doivent également introduire une AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ (alias une AMM).
La question posée aux hautes autorités d’un état par les firmes pharmaceutiques est surtout la suivante : « puis-je mettre mon médicament sur le marché et me rémunérer ? » Il n’est pas question ici de thérapeutique__
Pour que cette autorisation puisse être octroyée, une COMMISSION (dépendante de l’AFMPS — Agence fédérale du médicament et des produits de santé) rend un avis. Cette commission s’occupe de voir si le médicament proposé peut être mis sur le marché.
En principe, les membres de cette Commission ne peuvent pas avoir d’intérêts financiers avec des firmes pharmaceutiques qui pourraient nuire à leur impartialité. Ces personnes font chaque année une déclaration de leurs intérêts financiers, qui sont rendues accessibles au public (cf. loi belge de 1964 sur les médicaments).
Ensuite, il faut voir si l’État va intervenir dans le remboursement du médicament. On se tourne alors vers l’INAMI (Institut national d’assurance maladie-invalidité). Il s’agit de demander que la nouvelle substance active puisse figurer sur une des listes des médicaments pour lesquels un remboursement est prévu. Pour ce faire, une demande doit être introduite auprès de la commission de rembour-sement des médicaments (CRM). En effet, c’est elle qui donne des avis, à la demande du ministre des Affaires sociales, sur les aspects politiques en matière de remboursement de spécialités pharmaceutiques.
Et les médicaments psychiatriques ?
Un jour, un laboratoire pharmaceutique met sur le marché un médicament sous le nom commercial de Largactil — pour large action. Les premières publicités montrent une rose des vents avec quatre points cardinaux intitulés : chirurgie, obstétrique, médecine interne, psychiatrie. On ne peut pas faire plus vague.
La molécule à la base du Largactil est la chlor-promazine. Les chimistes vont surtout l’identifier pour ses effets antihistaminiques (effets sur des réactions allergiques) et vont partir d’elle pour trouver d’autres molécules qui pourraient avoir un impact sur le comportement des êtres humains.
Quand les chercheureuses mettent au point des neuroleptiques qui travaillent sur des récepteurs
dopaminergiques, c’est parce qu’iels savent que les premiers neuroleptiques inventés ont eu un effet
sur les récepteurs dopaminergiques (récépteurs impliqués dans les processus neurologiques). Iels
ont alors continué à chercher des substances qui agissaient sur les différents groupes ou sous-groupes
de ces récepteurs, en essayant d’inventer ainsi de nouveaux neuroleptiques et cela, sans rapport direct avec
ce que serait un véritable témoin fiable d’une pathologie, comme cela existe dans le modèle des pathologies
infectieuses.
Deux grandes classes de psychotropes vont alors rapidement se côtoyer : ceux adaptés à
l’hôpital et ceux adaptés à la médecine de ville. Les seconds sont issus des premiers dont ils sont la
version light. En effet, s’ils sont moins puissants et provoquent moins d’effets secondaires, alors il est
possible de les prescrire à des patient·es « moins malades », qui sont aussi potentiellement
plus nombreux·ses.
C’est ainsi que l’industrie pharmaceutique va identifier deux façons de fonctionner : soit elle met au point de véritables innovations qui bousculent la prise en charge d’une pathologie, soit elle élargit de manière importante les prescriptions de classes de médicaments déjà existantes. Dans ce dernier cas, cela donne l’impression que des innovations importantes ont eu lieu, car les effets économiques sont très importants.
En tout cas, l’introduction du Largactil va modifier en profondeur les pratiques psychiatriques de l’époque ; Elle va activement participer à la chute du nombre de malades hospitalisé·es ainsi qu’à l’apparition de demandes de type « consommatoire » où la plainte est accompagnée d’une demande implicite de solution immédiate.
Un peu de politique
Comment avoir prise là-dessus ?
Face à une industrie pharmaceutique qui entretient un certain niveau d’opacité sur ses essais cliniques et se centre surtout sur les médecins qui prescrivent les molécules qu’ils fabriquent (grâce à l’entremise de leurs nombreux délégués médicaux), nous pourrions devenir de plus en plus actifves dans l’histoire de nos prescriptions.
Nous pourrions nous intéresser davantage aux substances chimiques et aux médicaments que nous prenons, plus averti·es de la façon dont ils sont arrivés sur le marché, de la raison pour laquelle ils figurent sur ma prescription, bref, plus curieux·ses de leur histoire.
Par où commencer ?
En n’hésitant pas à s’informer sur le(s) médicament(s) que l’on prend auprès de son médecin généraliste ou spécialiste ainsi qu’auprès de son ou de sa pharmacien·ne, et ce afin d’en savoir plus sur les composantes du produit, son indication dans mon cas, ses éventuels effets secondaires.
Il existe des publications gratuites, consultables en version papier ou sur internet, qui fournissent une information claire et indépendante (sans lien d’intérêt avec les firmes pharmaceutiques) sur les médicaments prescrits en Belgique :
- Folia Pharmacotherapeutica est le mensuel du Centre belge d’information pharmacothérapeutique (CBIP) ; il est agréé par le service public fédéral Santé publique et consultable en ligne via ce lien http://www.cbip.be/nieuws/index.cfm?welk=730&category=GOW
- Répertoire commenté des médicaments (Centre belge de d’information pharmacothérapeutiques) ; consultable en ligne via le lien http://www.cbip.be/ggr/index.cfm?ggrWelk=MAIN
- Les archives des fiches de l’association Farmaka (Centre indépendant d’information sur les médicaments) ; agréée par l’AFMPS et l’INAMI, l’asbl a mis en libre accès de nombreuses fiches d’information sur la façon d’aborder une certaine pathologie ; ces fiches sont téléchargeables gratuitement en format pdf via http://www.farmaka.be/fr/publications
- Prescrire (revue francophone d’information médicale) ; Chaque mois, la Rédaction publie également des informations en accès libre ; voir le lien http://www.prescrire.org/fr/Summary.aspx
- Le réseau PIC, regroupant des professionnel·les de santé sans lien avec des firmes pharmaceutiques, fournit également des informations très précieuses sur les médicaments généralement prescrits dans le champ de la psychiatrie et de la santé mentale : https://reseau-pic.info/?page=../medicaments/nom.php&l=Fiches%20m%C3%A9dicaments
- Une série d’outils sont partagés sur le site TRIPSIT: des convertisseurs, mais aussi un guide des combinaisons (par ex : si j’additionne telle substance + telle substance, quel sera le résultat sur ma santé ?) https://benzos.tripsit.me/
Avoir besoin d’un médicament en poche, c’est me confirmer que j’ai besoin de cette béquille… qu’en cas de problème, non seulement je ne suis pas capable de m’en sortir, mais aussi qu’il n’y aura personne pour être présent, personne pour me tendre la main, personne pour m’écouter. Malheureusement c’est souvent le cas. Quand j’écoute les personnes souffrant de troubles psychiques, j’entends qu’au fond il y a l’isolement et la solitude, comme chez moi. Cela pose une question de société.
Questions à emmener chez sa / son prescripteur·ice afin de faire le point sur son traitement médicamenteux
- Pourquoi cette molécule / ce traitement m’est-il prescrit ?
- Quels sont les effets attendus en ce qui me concerne ?
- Quels sont les effets secondaires les plus fréquents pour cette molécule ?
- Puis-je prendre cette molécule avec les autres médicaments que je prends déjà ?
- À quel moment dois-je prendre ce médicament ? Le matin ? Le soir ? En mangeant ? etc.
- Dois-je passer des examens médicaux pour contrôler la prise de ce médicament ?
- Que se passerait-il en cas de surdosage de ce médicament ?
- Si je réalise que ce médicament ne me convient pas, quelles seraient les alternatives ?
NOS DROITS
Droits du patient
Une loi me protège en tant que patient·e aux prises avec une médication psychiatrique : la loi de 2002 sur les Droits du patient.
- J’ai le droit de choisir le médecin qui me suivra de façon régulière et me prescrira mon traitement ; je suis libre de choisir mon médecin / prestataire de soin et d’en changer si je ne me sens pas dans une relation de confiance.
- J’ai le droit de choisir une personne de confiance pour m’accompagner dans l’exercice de mes droits. Il suffit que cette désignation soit faite par écrit, datée et signée par moi et la personne de confiance choisie, enfin jointe à mon dossier médical.
- J’ai le droit d’être informé·e au sujet de mon traitement ; j’ai le droit de recevoir toutes les informations nécessaires à la bonne compréhension de mon état de santé et du traitement qui m’est prescrit. Cette information doit m’être formulée dans un langage clair et compréhensible, voire même délivrée par écrit si j’en fait la demande.
- ↳ À titre exceptionnel, un·e soignant·e peut refuser de me donner certaines informations, c’est ce qu’on
- appelle l’« exception thérapeutique ». Ce refus exceptionnel est encadré par la loi de 2002 et ne se justifie que si lea soignant·e estime que l’information peut constituer un préjudice grave pour moi, consulte un·e autre professionnel·le pour avis / confirmation et qu’iel motive son refus, alors joint à mon dossier médical. Si j’ai une personne de confiance, elle pourra quant à elle avoir accès à cette information. Dès que les risques de préjudice grave pour ma personne auront disparus, l’information devra m’être communiquée. Retenons néanmoins que le/la professionnel·le de soin ne peut me refuser aucune information nécessaire à la construction de mon consentement au traitement proposé.
- J’ai le droit de consentir ou pas au traitement que l’on me prescrit ; Aucun traitement ne peut m’être administré de force, sans mon consentement. Face à mon refus de consentir au traitement prescrit, tout médecin a le devoir de m’informer sur les conséquences encourues, me proposer un autre traitement, voire m’orienter vers un·e autre professionnel·le.
- ↳ En situation d’urgence, lorsque je ne suis pas / plus en mesure de consentir, lorsqu’il n’y a pas de volonté préalablement exprimée, un·e prestataire de soins doit commencer tous les traitements nécessaires. Mais, dès que mon état de santé le permettra, mes droits au consentement (et à l’information) devront à nouveau être appliqués.
- Si j’estime que mes droits sont bafoués, je peux porter plainte ; Je peux introduire gratuitement une plainte auprès du médiateur local ou fédéral. Il s’agit d’une mesure permettant d’encourager le dialogue afin de parvenir à une solution à l’amiable. Je peux me faire accompagner dans cette démarche par ma personne de confiance.
- ↳ Si j’estime qu’un de mes droits du patient n’est pas respecté par un·e praticien·ne professionnel·le travaillant dans un hôpital, je peux contacter le service de médiation de cet hôpital. Si le ou la professionnel·le concernée travaille dans un hôpital psychiatrique, une initiative d’habitation protégée ou encore une maison de soins psychiatrique, il est possible que lea médiateurice compétent·e soit celui d’une plate-forme de concertation en santé mentale auxquelles les institutions sont rattachées ; La liste de toustes les médiateurices actifves en Wallonie et sur Bruxelles est disponible sur le site du SPF Santé Publique, dans la section « services de médiation des Hôpitaux et des plate-formes de concertation en santé mentale »
Pour plus d’information sur cette loi et / ou pour vous procurer une brochure informative complète, rdv sur le site de l’Autre « lieu », sous l’onglet « campagnes » : https://www.autrelieu.be/campagne/campagne-2021-en-recherche-de-justesse/
Parce qu’à chaque fois que j’exprime que ça va mal, il y a toujours quelqu’un de bien attentionné/intentionné pour me demander si j’ai moyen d’ajuster mon traitement… Pas « est-ce que tu prends un traitement ? Peut-être qu’il y a un souci dedans ? » Encore moins « es-tu à la recherche de solution à laquelle je pourrais contribuer ? » Ou encore « y a-t-il des choses à faire pour apaiser ? » Non. « Peut-être qu’il faut ajuster ton traitement. » C’est impressionnant non ? Ce n’est pas « as-tu un traitement ? » mais bien « ajuste ton traitement ». Pour moi, ce présupposé culturellement partagé pose problème. Parce qu’on part du principe que s’il y a souffrance psychique, il y a forcément médication psychiatrique.
COMPLEXITÉ
Effets indésirables / dommages collatéraux
Les effets indésirables des médicaments sont aussi appelés effets secondaires.
Chacun·e n’aura pas une réaction identique à une molécule. Les effets varient selon les personnes. Les effets indésirables d’un médicament se trouvent sur la notice. Quand on est à l’hôpital, on n’a pas accès à la boîte du médicament, et donc pas non plus à la notice. Les notices peuvent se trouver sur internet.
En médecine générale, il est recommandé aux patient·es de lire les notices des médicaments. Prendre connaissances de ces informations permet d’identifier les problèmes qui seraient liés au traitement. Cette connaissance permet de prendre soin de soi de façon plus adéquate et de comprendre les réactions de son corps.
En psychiatrie, les médecins évitent souvent de parler des effets secondaires aux patient·es. Pourtant le fait d’être informé·e et de pouvoir identifier la cause d’une bizarrerie que nous vivons tout à coup est rassurant.
Nous avons constaté que la plupart d’entre nous n’ont pas lu la notice jointe à leur médication.
Certain·es ont témoigné du fait que leur médecin a minimisé les effets secondaires dont iels se sont plaints. Il y a entre autres, chez certain·es d’entre elleux, la croyance que parler des effets secondaires les feraient apparaître ; nous pensons que cette crainte / croyance pourrait également faire l’objet d’une discussion entre patient·es et praticien·nes.
Nos voisin·es aux Pays-Bas (psychose.net) ont développé un outil de comparaison des effets
secondaires des médicaments antipsychotiques. Il suffit de sélectionner deux ou plusieurs
molécules pour obtenir la comparaison des effets secondaires recensés.
De plus, les descriptions des effets secondaires liées à chaque molécule sont claires et précises. Cet outil peut être une aide pour comprendre et choisir ses médicaments. L’outil n’existe pas encore en français.
Aujourd’hui encore, quand on traverse des périodes de grand trouble, on doute. Alors qu’on sait. On sait que les effets secondaires nous ont brisé en offrant tellement peu en échange. On sait qu’ils ont nourri la folie au lieu de la contrer. On sait qu’une partie des comportements auto-destructeurs qu’on a eu à l’époque étaient dictés par une volonté de se purger de ça. On sait. Et pourtant, ils arrivent encore à nous faire douter. Quand des genxtes expliquent qu’ils ont besoin de leur traitement, que vraiment c’est essentiel pour eux, je viens pas leur foutre les études sous le nez ou argumenter comment leur vie serait mieux sans. Non. Je respecte leur choix. J’aide mes proches à se souvenir de les prendre. Je ne juge pas. Je ne prétends pas mieux savoir. J’ai juste appris ce qui est bon pour moi. Et j’apprécierais qu’on me rende la politesse. Tout le monde. Tout le monde pense mieux savoir que moi. Et même quand je dis que j’ai failli crever, que ça a failli me tuer, ça ne suffit toujours pas. « C’était sans doute pas la bonne molécule pour toi ». Mais aller vous faire foutre putain… vraiment… j’ai plus l’énergie de tourner ça poliment et joliment et politiquement… Désolé ! J’en ai marre qu’on efface toutes les épreuves qu’on a vécues à cause de merdes de pilules juste parce que personne n’est capable d’envisager un autre possible pour les genxtes comme moi. Alors si tout ce qu’on a à me proposer pour m’aider c’est d’ajuster mon traitement, alors arrêtez de m’aider. Vous ne m’aidez pas. Et toute façon je ne vous avais rien demandé.
Pressions
Inquiétudes de la famille, peurs des médecins, …
L’entourage pro et non pro nous met souvent la pression pour que l’on prenne nos médocs.
Les médicaments ont peut-être adouci une période houleuse à un moment donné. Alors cet entourage fait le lien entre médication et amélioration. Même si ce n’est pas forcément le cas pour la personne qui prend des médicaments.
Le mythe actuel selon lequel le médicament serait l’unique réponse aux troubles psychiques
perdure.
Refuser une médication, c’est perçu comme un refus de soins. Une personne qui a des insomnies
qui pèsent sur sa vie quotidienne, et qui refuse de prendre des médicaments pour dormir, cela sera perçu
comme un refus de se soigner, refus de se faire du bien. Or, ce refus peut être une envie de prendre
soin de soi tout autrement.
Certai·nes soignant·es ont peur pour « leur » patient·e, peur que les symptômes dégénèrent, peur de la crise. Iels ont peur pour elleux car iels se trouvent investi·es d’une responsabilité légale (morale ?). C’est plus facile / plus rapide de forcer son opinion sur quelqu’un d’autre que de l’écouter attentivement et de prendre en compte son opinion. Beaucoup de soignant·es présupposent, consciemment ou non, qu’ils savent mieux que le « malade » qui aurait un jugement vicié / inadéquat.
Par ailleurs, beaucoup de soignant·es sont pris·es dans un système (manque de temps, de personnel, de moyens) et une mentalité qui poussent au surmenage. Prendre soin de soi ce n’est pas qu’un impératif pour les « soigné·es », pour les soignant·es aussi.
Tiens… c’est bizarre ces expressions de « soigné·e » et de « soignant·e », comme si l’un ne recouvrait jamais l’autre.
Questions à me poser :
- Est-ce qu’il faut parler de son traitement ?
- Et si je décide d’en parler :
comment, de quelle façon ?
AUTRES PARADIGMES
Réduire ? Arrêter ? Utilité des médocs ?
Importance de garder ça à l’esprit : l’arrêt brusque (sans palier de diminution, sans soutien) peut mener à une hospitalisation et à une augmentation de la prise de médicaments initiale, car le changement est trop radical. Le corps et l’esprit étant habitués à fonctionner avec un certain dosage de médicaments psychotropes, l’arrêt soudain ou trop rapide — de l’ordre de 50 %, voire de 25 % de la dose initiale — peut constituer un choc.
Décider d’ajuster, de diminuer ou d’arrêter progressivement les médocs, c’est ouvrir la porte à un processus qui peut être long, rempli d’émotions intenses et marqué par le découragement, mais aussi par des moments d’enthousiasme où on se sent mieux. C’est bouleversant et ça demande de l’attention, puis du soutien.
Questions à poser au psychiatre :
- Qu’est-ce que ça va me faire de réduire ?
- Qu’est-ce que ça va me faire si j’arrête ?
- Il faut diminuer progressivement, ou je peux arrêter d’un coup ?
- Comment s’y prendre pour tenter d’ajuster / diminuer / arrêter ? (méthode)
- Quel effet souhaitez-vous atténuer / supprimer en me proposant de revoir l’utilisation d’un tel médicament ? (Se demander à soi-même : est-ce que moi aussi je veux diminuer / stopper cet effet ?)
Pistes concrètes
Nos comparses du RRASMQ (Regroupement des Ressources Alternatives en Santé mentale) se préoccupent depuis longtemps de la question des médicaments, puis aussi aux vécus et aux rapports qu’on peut avoir avec cette médication psychotrope.
Dans leurs travaux et les témoignages rassemblés, iels rapportent une sorte de « silence radio » sur une dimension pourtant importante du médicament : celle de sa diminution ou de son arrêt et des potentiels effets de sevrage. Pour trop de personnes, le médicament est prescrit comme une finalité alors que des recherches récentes démontrent qu’il ne devrait pas être une fatalité. Le RRASMQ attire l’attention sur le fait que nos prescriptions ont souvent des contours temporels flous, comme si la question de l’arrêt des médicaments était tout aussi secondaire que ses effets dits secondaires. Or cette absence du thème de l’arrêt de la médication dans les discours médicaux pose problème, car arrêter un médicament, c’est être confronté·e à des possibles enjeux de sevrage. Et certain·es professionnel·les peuvent avoir tendance à les négliger, à les ignorer ou à les banaliser. D’où l’importance d’en parler et de construire un outil qui puisse soutenir chacun·e dans ses souhaits d’ajuste-ment, de réduction voire d’arrêt de la médication.
La GAM = une démarche qui s’appuie sur une vision globale de la personne et de son mieux-être dans une perspective d’appropriation du pouvoir. C’est aussi un outil pratique, téléchargeable gratuitement ici : http://www.rrasmq.com/GAM/presentation.php
Le projet Icarus est un réseau de soutien et de partage par et pour les personnes dont les manières d’expérimenter le monde sont souvent diagnostiquées comme des maladies mentales. Il met en avant la justice sociale en encourageant les pratiques d’aide mutuelle qui reconnectent guérison et libération collective. Car nous nous transformons nous-mêmes en transformant le monde qui nous entoure.
Parmi leurs travaux, on trouve un « Guide pour décrocher des médicaments psychotropes en réduisant les effets nocifs ». Comme nous, ils mettent en avant une démarche pragmatique, non dogmatique. Le réseau défend d’ailleurs une posture d’éducation sanitaire communautaire qui reconnaît qu’il n’existe pas de remède unique valable pour tout le monde, pas de standard universel de « succès » ou « d’échec ». Se débarrasser du problème n’est pas nécessairement la seule solution. La réduction des effets nocifs préfère accepter les personnes là où elles en sont et les soutenir dans des choix éclairés et des compromis calculés qui diminuent les risques et augmentent le bien-être.
Il est question d’encourager à peser les différents risques impliqués: les effets nocifs des états extrêmes, aussi bien que les effets nocifs des traitements, tels que les effets indésirables des médicaments, les étiquettes invalidantes, et les hospitalisations traumatisantes.
Prendre des décisions basées sur la réduction des effets nocifs signifie analyser honnêtement tous les côtés de l’équation : l’aide que peuvent apporter les médicaments lorsqu’une vie semble hors contrôle, à quel point ces mêmes médicaments peuvent être risqués, et les différents choix et alternatives. Toutes les décisions impliquent un processus d’expérimentation et d’apprentissage, y compris un apprentissage à partir de ses erreurs et un changement d’objectifs en cours de route.
https://icarus.poivron.org/guide-pour-decrocher-des-medicaments-psychotropes/
Certain·es d’entre nous ont expérimenté ce qu’on appelle le « tapering » ; il s’agit d’une méthode permettant de réduire progressivement les doses de médicaments pour atteindre des doses minimales thérapeutiques, voire l’arrêt total sans risquer les rechutes et les effets de sevrage.
Au début on va vite puis on freine ; plus les doses se rapprochent de zéro, plus on réduit au « compte-goutte ». Et si on sent qu’on va trop vite, on peut faire un palier, ou alors on attend avec la même dose, ou encore avec la dose précédente.
Ça permet d’éviter d’avoir à sauter un jour sur 2 ou un jour sur 3 pour réduire. Ou de sauter de 5mg ou 2,5mg à zéro comme on le fait trop souvent avec les comprimés les plus petits.
ça n’existe pas beaucoup à l’heure actuelle dans notre psychiatrie mais ça permettrait aux médecins de déprescrire et d’éviter aux patient·es nombre de rechutes liées à l’arrêt brutal des médicaments.
C’est grâce à l’association COMME DES FOUS que nous avons découvert cette méthode. C’est par ici :
https://commedesfous.com/comment-et-pourquoi-diminuer-les-antipsychotiques/
Le frein principal c’est la méconnaissance des médecins quant aux effets du sevrage. Lorsqu’on diminue ou arrête un médicament, il y a souvent des effets liés à cet arrêt. Ces effets sont très souvent confondus avec les symptômes d’un trouble psychique. Dès qu’ils (re)apparaissent, lea spécialiste va se voir confirmer la chronicité et la gravité de la maladie. Et inciter la personne à reprendre un médicament afin de calmer ces soi-disant symptômes.
Questions qui peuvent aider à orienter un choix concernant la médication là où on se trouve aujourd’hui :
- De quoi ai-je besoin ?
- Quelles sont mes forces et mes fragilités ?
- Qui pourrait m’aider / être à mes côtés ?
Questions adressées au médecin :
- Est-ce que vous oserez quitter avec moi le chemin rassurant et tout tracé de la psychiatrie conventionnelle ?
- Acceptez-vous de rester à mes côtés malgré les incertitudes ?
- Pouvez-vous adopter avec moi une attitude de recherche, d’ouverture, de curiosité ?
Du « cas par cas »
Les réactions à un médicament varient d’une personne à une autre. Un même médicament ne fait pas le même effet à chacun. L’expérience personnelle est la référence de base.
Le choix n’a pas à être définitif. Le cours de la vie est imprévisible, nous traversons tous des lieux et des évènements variables. Nos envies, nos besoins, nos priorités changent. L’avenir déborde d’inimaginables inimaginés. Nous sommes des êtres en perpétuelle invention.
L’idée c’est de bien choisir « pour maintenant » et de rester ouvert·e aux possibles multidimensionnels.
Recherche de ma dose qualité de vie
Grumpff… c’est du bricolage de ce qui fonctionne, ce n’est ni une expertise ni une expérience transmissible, juste un témoignage qui peut aider à décaler certaines évidences. Et attention à ne pas influencer quelqu’un·e pour qui ce n’est pas adapté.
Voir si un médoc ne permet pas d’en éviter un autre. (Exemple : si mon antihistaminique me fait dormir,
cet effet secondaire peut « m’arranger », selon le contexte.)
Utilisation ajusté à mes
activités (par exemple anti-dépresseur : d’habitude oui / mais un jour de fête où je boirai
de l’alcool, non.)
Diminuer en en prenant un jour sur deux.
Utilisation d’un médicament « le temps d’une crise » ; ajuster au jour-le-jour selon le besoin ;
Je vais mieux, ça a l’air de tenir. Le jour où je suis « très occupée », par des activités socia(b)les agréables, j’ai oublié mon anti-dép, sans nuisance. Je le refais par la suite, de façon plus consciente, pour baisser la dose.
Qui sont les expert·es ?
Dans une vision nouvelle du soin de santé mentale, les expert·es ont chacun leur type de connaissance. Les professionnel·les ont avant tout un savoir théorique. Nous, les personnes concernées, nous avons l’expertise du vécu. Nous sommes chacun·ee la personne la plus experte de nos propres troubles.
Les psychiatres m’avaient expliqué que je devrai prendre des médicaments psychotropes à vie. D’où leur est venue cette certitude ? Ça fait plus de 10 ans que je ne prends pas de médicaments. Je suis sensée ne pas pouvoir fonctionner sans en prendre… selon les convictions de la psychiatrie conventionnelle.
Tout n’est pas dans la substance chimique…
Des études ont été menées en vue de comparer différentes techniques de psychothérapie afin de pouvoir
déterminer lesquelles sont les plus efficaces. Les chercheureuses ont été surpris·es des résultats.
Ces
études ont révélé que dans l’efficacité de l’une ou l’autre thérapie, la technique ne joue en réalité qu’un
petit rôle. Ce qui s’est révélé essentiel, c’est la qualité de la relation entre la personne et le ou
la thérapeute.
Etendue aux consultations chez des psychiatres, le résultat va dans le même sens : la qualité des consultations est liée en toute grande partie à la qualité du lien qui se crée entre la personne et son ou sa psychiatre, et seulement en petite partie selon le médicament prescrit.
Les professionnel·les du soin peuvent nous aider avec les outils qu’iels ont appris, mais c’est la qualité des liens qui se tissent qui sera le plus nourrissant, le plus bénéfique pour nous.
Certain·es d’entre nous ne se reconstruisent
pas par des psychothérapies et / ou avec l’aide d’une médication prescrite. D’autres trouvent un chemin
dans une religion, des pratiques chamaniques, … Pour d’autres encore, ce seront via des pratiques
artistiques ou le sport, la méditation ou le bénévolat / travail qu’iels vont trouver leur chemin.
C’est souvent grâce à un mélange de
plusieurs de ces pratiques que nous pouvons retrouver ou reconstruire le fil de nos vies.
En tout cas, nous on se dit que c’est mieux de ne pas faire tout seul, puisque les symptômes sont l’expression de souffrances dans les liens.
Pas sans construire, mettre en place d’autres choses. Diminuer un médicament, c’est possiblement
enlever un produit qui diminuait des vécus pénibles ou insupportables. C’est plus facile de le diminuer tout
en mettant d’autres choses en place. Des amitiés, une nouvelle activité, …
Ce n’est pas toujours
possible de faire cela tout de suite. Pouvoir faire des choses engagées vers l’extérieur demande d’être
suffisamment ok avec soi-même. Prendre son temps.
Nos mots, notre histoire
Les critères, les classifications, les noms enseignés et appris par les professionnel·les de la psychiatrie ne sont pas les mêmes d’un pays à l’autre. La définition de la schizophrénie n’est pas la même en France qu’aux États-Unis.
Le vocabulaire de la psychiatrie, loin d’être une science exacte, est une sorte de culture qui peut donner une impression de prise aux professionnel·les, mais leurs mots disent très peu comment se vivent, comment se re-sentent les personnes concernées.
Les diagnostics et autres mots-valises peuvent être réducteurs dans le sens où cela nous met dans des cases. Les soignant·es vont alors s’adresser à une pathologie, à des symptômes plutôt qu’à l’individu qui se tient face à eux.
Nous croyons que les « délires » ont un sens. Ils ne sont pas seulement un symptôme à faire taire ; ils racontent quelque chose de notre histoire, quelque chose de notre passé. Ils sont parfois la seule façon d’exprimer l’inexprimable.
Nous sommes les meilleur·es spécialistes de nos troubles. Nous sommes les mieux placé·es pour en parler. Notre savoir est précieux, et il n’est pas assez reconnu comme tel. Nous devons le défendre.
Plutôt que d’utiliser les mots préfabriqués des expert·es, nous avons besoin de développer notre propre vocabulaire. Nous avons envie de trouver nos mots, de trouver nos voix.
Nous souhaitons confectionner des approches ajustées / à la hauteur de nos expériences / de nos trajectoires. Des approches qui tiennent en compte également de nos droits et des conditions de notre émancipation.
Je trouve que les genxtes qui sont plus aisé·es économiquement sont mieux soutenu·es ou mieux encadré·es que les genxtes défavorisé·es économiquement. Je voudrais qu’il y ait une égalité des chances face à la maladie. Que les soins réservés à une sorte d’élite socio-économico-culturelle soient répartis, dispensés de manière plus égalitaire.
Il n’y a pas que la molécule qui soigne
En matière de santé mentale, il existe aussi des inégalités sociales de santé. Le statut socio-économique a un impact décisif dans la prévention, le déclenchement, le vécu et le rétablissement des troubles psychiques. En Belgique, une étude des Mutualités Chrétiennes auprès de leurs affiliés a montré que la classe la plus faible présente un risque de consommation de médicaments psychotropes accru de 14 % par rapport à la classe la plus élevée. Les personnes issues de la classe sociale la plus faible ont un risque de près de 60 % plus élevé par rapport à la population de référence (ensemble des affiliés) d’être hospitalisé·es en psychiatrie.
Il existe également un lien entre le statut socio-économique et les hospitalisations en psychiatrie tant au niveau des admissions, du traitement que des sorties. En outre, plus ce statut socio-économique diminue, plus les admissions se font sous la contrainte (mesures judiciaires de protection de la personne malade mentale). Il est à noter que ces personnes se voient rarement proposer des parcours personnalisés de résilience, ce qui entraîne de sempiternels allers-retours en milieu de soin psychiatrique ainsi qu’un décrochage sociétal important.
La prise en compte des conditions de vie semble jouer un rôle majeur pour réduire les inégalités sociales de santé dans le champ de la santé mentale. L’OMS recommande de considérer la santé mentale et le bien-être psychologique comme dépendants non seulement des ressources psychiques d’une personne mais aussi du contexte social dans lequel elle se trouve et de l’environnement dans lequel elle évolue — ces déterminants s’influencent mutuellement de façon dynamique et peuvent tout autant menacer ou protéger l’état de santé mentale de la personne.
Faciliter l’accès à des conditions de vie qui génèrent une bonne santé psychologique permet aux personnes — qui ont parfois intériorisé un état de précarité psychique et socio-économique — de rebondir. Il apparaît dès lors pertinent de ne pas se limiter à améliorer les services (curatifs) de soins de santé mentale, mais aussi la qualité du logement, les possibilités de trouver un emploi ou une formation, les conditions d’accès à la culture, etc. Tout cela demande des espaces qui permettent de (re)qualifier la place et la parole des plus vulnérables psychiquement et socio-économiquement.
Déconstruire nos étiquettes, oser
questionner les prédictions qu’on nous assène ; ne pas boire les paroles des professionnels sans
respirer, ne pas tout prendre pour argent comptant ; nous informer sur ce qui semble nous
arriver ; faire d’autres hypothèses.
Des ressources qui ont été importantes
Notre groupe MÉDOCS nous a permis d’expérimenter de nouvelles approches :
- ÉTAYER, développer quelque chose en soi / pour soi ; poursuivre ce qui fait vie en nous.
- APPARTENANCE, seul·e mais à plusieurs et vice versa. Se sentir entouré·e, sans être étouffé·e.
- LIAISON, liaison entre plusieurs milieux où les cheminements ressourcent, ne sont pas embués par le passé et nos peurs. Se pointe ici la question de la direction, du sens de nos trajectoires.
- OUVERTURE, rester ouvert·e ; être disponible pour de nouvelles rencontres / de nouveaux trajets / de nouvelles interactions.
Édition : L’Autre « lieu » — RAPA (Recherche-Action sur la Psychiatrie et les
Alternatives)
En santé mentale particulièrement, tout se joue dans les relations qui sont bien souvent des relations de grande dépendance des destinataires du soin à l’égard de ceux qui le prodiguent. La tâche première de l’Autre « lieu » consiste en l’exploration d’un travail du soin qui n’est plus à la charge exclusive des professionnels de la santé et des intervenants sociaux. Il invite chacun d’entre nous à prendre soin du soin et à déplacer ses propres zones d’intervention, il trace un horizon qui fait de la vulnérabilité (comprise comme condition d’interdépendance fondamentale des humains) l’aiguillon critique capable d’approfondir notre conception même de la santé : en pensant cette vulnérabilité comme le point de départ / d’achoppement d’une immunité plutôt que comme une entorse à celle-ci.
Co-chercheuses et co-chercheurs engagé·es dans cette enquête : Val, Sophie, Marion, Thomas, Sonia, Yannick, Philippe, Agapao, Stéphane, Patricia, Audrey, Daniel, Valère, Lionel, Fabrice, Valérie et Auré.
Si vous souhaitez plus d’informations concernant cette recherche, contactez Auré à l’Autre « lieu » via aurelie.ehx@autrelieu.be / vous pouvez aussi directement nous passez un petit coup de fil au 02/230.62.60 ou pousser la porte du n°5 de la rue de la Clé (ouvert du lundi au vendredi entre 12h et 16h30).
FONTES /// (̾●̮̮̃̾•̃̾) altera regular ۜ\(סּںסּَ` )/ۜ et Fraunces (ligatures web-to-pdf ❤) IMPRESSION ///
R·DRYER Bruxelles
GRAPHISME /// Loraine Furter, Alice Marion, web-to-pdf ❥